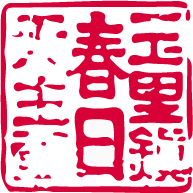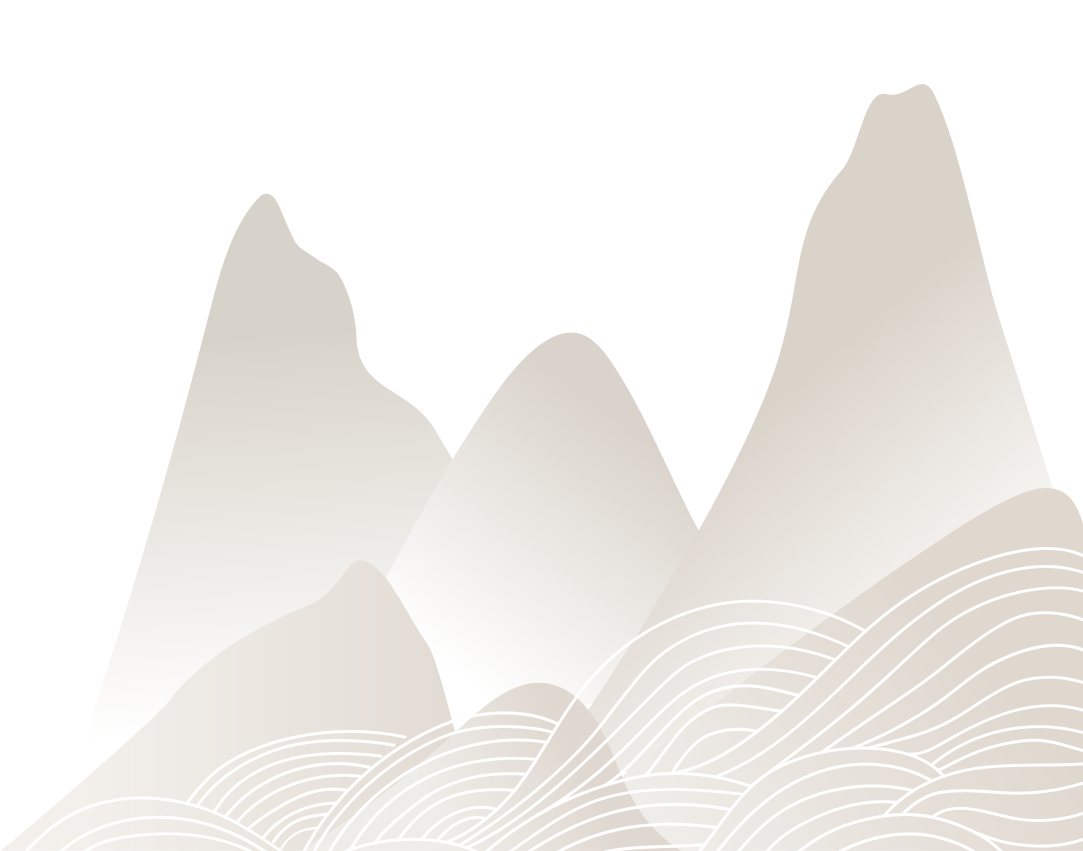Jean-Claude MICHE1805 - 1873
- Status : Vicaire apostolique
- Identifier : 0423
- Bibliography : Consult the catalog
Identity
Birth
Death
Episcopal consecration
Missions
- Country :
- Malaysia - Singapore
- Mission area :
- 1836 - 1838
- 1840 - 1841
- 1843 - 1844
- Country :
- Thailand
- Mission area :
- 1838 - 1838
- Country :
- Cambodia
- Mission area :
- 1838 - 1840
- 1848 - 1864
- Country :
- Vietnam
- Mission area :
- 1841 - 1843 (Saigon)
- 1844 - 1848 (Saigon)
- 1864 - 1873 (Saigon)
Biography
Jean-Claude MICHE
Jean-Claude Miche naquit le 9 août 1805 à Bruyères (Vosges). Issu d’une famille modeste, il entra au petit séminaire de Sénaide, puis poursuivit ses études au grand séminaire de Foucharupt et fut ordonné prêtre le 5 juin 1830 à Saint-Dié. Son frère Joseph, curé de Moyenmoutier, demanda qu’il fut nommé vicaire dans sa paroisse ; en 1832, il le suivit à Fraize.
L’abbé Miche rejoignit le séminaire des Missions étrangères le 10 septembre 1835. Cependant, il n’y demeura que quelques mois. Après un premier départ avorté suite à une violente tempête dans le golfe de Gascogne, il quitta la France le 15 avril 1836 à bord de la Denise pour rejoindre le vicariat apostolique de Cochinchine. Mais en raison de la persécution de l’empereur Minh Mang, il ne put rejoindre sa mission. Aussi étudia-t-il la langue vietnamienne au Collège général de Penang. En 1838, Mgr Taberd l’envoya avec Pierre Duclos auprès des chrétiens de Battambang au Cambodge, royaume relevant de son autorité. Les deux prêtres y parvinrent la veille de Noël. Durant une année, ils relevèrent cette communauté abandonnée depuis près de quarante ans par le clergé. Mais la révolte du prince khmer Ang Em en 1839 provoqua la dispersion de la population par l’armée siamoise et l’effondrement de la petite Église cambodgienne.
Après un nouveau séjour au Collège général où il servit comme professeur de théologie morale, il parvint à entrer en Cochinchine le 19 juin 1841. Il s’établit à Go Thi, près de Quy Nhon, auprès du nouveau vicaire apostolique, Mgr Cuénot, et fut nommé provicaire. À ce titre, il fut étroitement associé à la tenue d’un synode au cours duquel furent étudiés les questions concernant l’administration des sacrements et la conduite des missionnaires.
Au début de l’année 1842, l’évêque l’envoya avec Pierre Duclos auprès du peuple Ê-dê, sur le plateau du Dak Lak, aux confins du Cambodge. Mais les deux missionnaires furent arrêtés durant leur voyage par les autorités vietnamiennes. Torturé dans la prison de Tuy Hoa, Jean-Claude Miche reçut 45 coups de bâton et fut condamné à mort avec son compagnon. Cependant, l’empereur Thieu Tri ne fit pas exécuter la peine. Les deux missionnaires, ainsi que trois autres prêtres des Missions étrangères furent libérés le 16 mars 1843 lors du passage de la corvette française l’Héroïne, grâce à l’action du capitaine Favin-Lévêque.
Après une nouvelle année passée au Collège de Penang, Jean-Claude Miche retourna en Cochinchine. Mgr Cuénot l’envoya dans le village catholique de Lai Thieu, près de Saïgon. Peu après la division du vicariat, il fut nommé (1846) coadjuteur de Mgr Lefebvre, nouveau vicaire apostolique de Cochinchine-occidentale, et fut sacré le 13 juin 1847 dans une étable pour ne pas éveiller l’attention des autorités. Il s’établit ensuite à la frontière du Cambodge où il renoua des relations avec les chrétiens. À l’invitation du roi Ang Duong, il partit pour la ville d’Oudong, près de laquelle il refonda le village catholique de Ponhea Lu en 1848. Le 30 août 1850, le pape Pie IX érigea le vicariat apostolique du Cambodge à la tête duquel fut placé Mgr Miche. Cependant, des dissentions avec Mgr Lefebvre le retinrent en Cochinchine durant près de deux ans.
Face à l’échec de l’évangélisation auprès des Khmers, l’évêque envoya ses prêtres au Laos, territoire associé à la mission du Cambodge. Mais la mort de plusieurs missionnaires mit fin à ces tentatives. Seule la fondation de la chrétienté de Kampot, puis de quelques communautés vietnamiennes le long du Mékong permirent un timide développement de la mission.
Au cours de la décennie 1850, le roi Ang Duong chercha à développer des relations diplomatiques avec la France par l’intermédiaire de Mgr Miche, afin de se libérer de la suzeraineté du Siam. D’abord fortement opposé à l’idée d’une ingérence européenne dans les affaires cambodgiennes, le vicaire apostolique facilita cependant une première tentative française menée en 1856 par Charles de Montigny pour établir des relations commerciales et politiques entre les deux nations. Mais après la prise de Saïgon (1859), il se rallia à l’idée d’un protectorat sur le royaume khmer. Jean-Claude Miche joua ainsi un rôle de premier plan dans les négociations entre le roi Norodom et l’amiral de La Grandière qui conduisirent au traité du 11 août 1863.
Nommé vicaire apostolique de Cochinchine-occidentale à la fin de l’année 1864, il s’établit à Saïgon tout en demeurant administrateur du Cambodge. Il obtint ainsi le redécoupage de la mission par l’adjonction de deux provinces vietnamiennes afin d’assurer un ancrage chrétien plus fort au vicariat. En Cochinchine, il développa la mission à travers la construction d’églises, du séminaire de Saïgon ainsi que par la fondation de communautés religieuses.
En 1872, Jean-Claude Miche choisit pour coadjuteur Isidore Colombert. Il mourut le 1er décembre 1873 au séminaire de Saïgon et fut inhumé dans le tombeau de Mgr Pigneau de Béhaine. Lors de la destruction du cimetière d’Adran par le régime communiste, ses cendres furent rapportées en France et déposées dans la crypte de la chapelle du séminaire des Missions étrangères.
References
Ouvrages :
B. CHOVELON, Doudart de Lagrée, marin, diplomate, explorateur, Presses universitaires de Grenoble, 1998.
H. DARRIEUS, La corvette l’Héroïne, Éditions de l’ancre marine, 1998.
F. JOYAUX, Nouvelle histoire de l’Indochine française, Perrin, 2022.
Thèses :
B. PATARY, Homo Apostolicus. La formation du clergé indigène au Collège général des Missions Étrangères de Paris, à Penang (Malaisie), 1808-1968 : institution et représentations, Thèse de doctorat en histoire, 2009.
Articles :
P. LAMANT, « Les prémices des relations politiques entre le Cambodge et la France vers le milieu du XIXe siècle », in Revue française d'histoire d'outre-mer, t. 72, n°267 (1985), pp. 167-198.


 Download
Download